On dit qu’on ne juge pas un livre à sa couverture mais c’est pourtant à la seule vue de celle du tome 1 de Rooster Fighter que je me suis lancé dans la lecture de ce manga, en 2022. Publié environ deux ans plus tôt au Japon, le manga m’a fait forte impression avec ce coq à l’allure bagarreuse. Quelques pages feuilletées plus tard, je l’emportais avec moi pour en découvrir davantage. Désormais, nous en sommes à 5 tomes disponibles et je les ai tout bonnement dévorés.
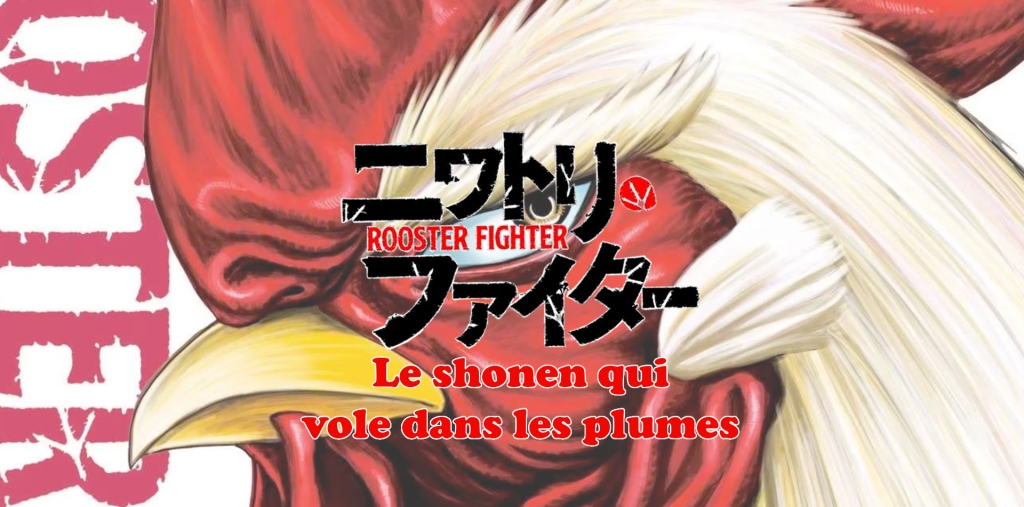
Du nouveau dans la basse-cour
Comme je le disais, Rooster Fighter – Coq de Baston (de son titre complet que nous n’utiliserons plus ici) est un manga dont la publication a démarré en 2020 mais pas dans un titre comme Weekly Shōnen Jump par exemple : c’est en ligne qu’il a fait son apparition. Plus exactement, c’est Hero’s Inc. qui en a initié la diffusion sur son site Comiplex. Viendra l’année suivante le temps de la publication papier et, mieux encore, d’une distribution à l’international, Rooster Fighter trouvant place dans les librairies d’Amérique du Nord mais également du Brésil, d’Argentine, du Mexique et, pour ce qui nous intéresse, de France enfin. Chez nous, c’est Mangetsu qui se charge de distribuer le manga, me donnant donc l’occasion d’apporter un petit coup de projecteur sur ce jeune label.

Filiale de l’éditeur Bragelonne, Mangetsu est comme je le disais une très jeune marque. Lancée seulement au printemps 2021, elle a cependant su se faire une place dans les étals de nos libraires à grands coups d’une présence en ligne très marquée et surtout de l’arrivée dans leur catalogue de titres et auteurs/illustrateurs de renom. Aux côtés de Rooster Fighter, une de ses séries phares, Mangetsu publie également Deep3, shonen de basket très apprécié, mais aussi et surtout les œuvres de deux stars : le maître du manga horrifique Junji Ito et ensuite Tetsuo Hara, créateur notamment de Ken le Survivant. Rapidement donc, Mangetsu a su joliment commencer à s’imposer au sein de la galaxie des éditeurs de mangas et Rooster Fighter a été un titre important dans cette démarche. A noter enfin que le label organise tous les 28 jours (selon le cycle lunaire, son nom signifiant « pleine lune » en Japonais) une émission en live (Tsukimi) qui amène l’annonce d’une nouvelle série à venir pour leur catalogue, lequel s’étoffe ma foi très joliment depuis son lancement.
Tant que nous en sommes aux présentations d’usage, évoquons maintenant l’auteur de Rooster Fighter. C’est à Shu Sakuratani que nous devons ce manga, qui demeure aujourd’hui sa principale œuvre. Je tiens à préciser ici que j’ai trouvé plusieurs orthographes communément acceptées pour le prénom de l’auteur (Syu, Syuu, Syū, Shuu ou encore Shū) mais c’est bien celle employée sur les couvertures de notre édition française du manga que je vais retenir dans ces lignes.
Si Rooster Fighter constitue son principal fait d’armes, Shu Sakuratani avait cependant entamé sa carrière en 2015 avec la publication de T-Dragon, un seinen (donc une œuvre plus adulte) à la croisée entre SF et horrifique qui mettait en scène Kôtarô Nakamaru, jeune lycéen tout à fait ordinaire qui souhaite devenir champion de kendô mais qui, alors qu’un virus mortel se propage, s’engage dans une équipe spéciale visant à en découvrir l’origine et à l’anéantir. Le virus se trouve alors être un alien microscopique et la seule solution sera de réduire la taille des membres de l’équipe pour l’affronter. Contrairement à Rooster Fighter, T-Dragon n’a jamais fait l’objet d’une publication papier hors du Japon. Diffusés à l’origine en ligne par Hero’s Inc dans l’archipel, c’est de la même manière que les 10 tomes de la série (désormais terminée) arrivent en France via la plateforme piccoma.com, où les deux premiers chapitres du tome 1 sont d’ailleurs disponibles à la lecture gratuitement.
Du reste, c’est bien avec Rooster Fighter et grâce à son édition papier que le mangaka s’est fait connaître. Une renommée encore à confirmer mais à mon sens méritée qui tranche d’ailleurs avec le caractère réservé, sinon timide, de cet auteur dont je réalise à l’écriture de ces lignes que j’ignore même son visage. Un coup sur Google Images ne m’en apprend d’ailleurs pas plus, me faisant regretter encore un peu de ne pas avoir pu me rendre à sa récente séance de dédicaces au cours de la dernière Japan Expo.
Qu’on se le dise, c’est à un auteur très discret que nous avons affaire là. Quoique présent sur les réseaux sociaux (notamment Twitter et Instagram), il s’y épanche peu, la majorité de ses publications visant à remercier les fans (dans leur langue maternelle !) ou à partager des dessins de Keiji le coq de baston aux couleurs des différents pays dans lesquels le manga a su trouver son public.

Keiji devant la Tour Eiffel, extrait du dessin de remerciement de Shu Sakuratani à ses fans de France
Comme un coq en pâte
Mais Rooster Fighter, de quoi s’agit-il ? La série met en scène Keiji, coq solitaire et taciturne qui mène sa quête personnelle : vaincre les kijû et, surtout, le kijû blanc qui lui a pris sa sœur. Car dans l’univers de Rooster Fighter, d’étranges créatures ont fait leur apparition. Les kijû sont des monstres gigantesques, mutants difformes autrefois humains et nés des pires aspects de ceux qui se sont ainsi retrouvés transformés. Ce sont des hommes et des femmes qui – littéralement – se sont laissées posséder par leurs mauvais sentiments et leurs mauvaises actions, au point de devenir à l’extérieur les monstres qu’ils sont sans doute à l’intérieur. Dit comme cela, j’imagine que ce n’est pas tout à fait clair mais comprenez que j’entretiens le flou volontairement : en dire plus reviendrait à en dire trop et la découverte de ces créatures mérite de se faire au gré de la lecture, surtout que la question des kijû est émaillée de nuances pertinentes qu’il serait dommage de détailler ici.

Le fait est que nous suivons donc Keiji dans cette lutte. Bien entendu, en bon personnage de shonen, ce n’est pas un coq comme les autres. Au-delà de son caractère bien trempé, Keiji est aussi et surtout fort comme un bœuf, capable de venir à bout de ces créatures avec des attaques volontiers au terme de combats dantesques.
Au gré de son périple, il rencontrera deux autres personnages qui, bon gré mal gré, l’accompagneront sur la route. Il y a tout d’abord Piyoko, petit poussin aux tristes origines qui s’éprend de Keiji comme un enfant s’éprend de son idole et qui va donc le suivre partout. L’autre protagoniste est une poule du nom d’Elizabeth. Coriace, elle traque elle aussi les kijû mais, à la différence de Keiji, fait preuve de plus de sagesse, sinon d’intelligence. Car en effet, ces trois personnages ont des identités et des personnalités très marquées et le moins que l’on puisse dire, c’est que Keiji ne brille pas spécialement pour la qualité de sa réflexion. Présomptueux et fier, le coq colle finalement à l’image que l’inconscient collectif a de cet animal. Et si sa quête de vengeance reste sa boussole, il n’est pas rare de le voir distrait par la vue d’une jolie poule et de mets capables de le rendre complètement accro. Volontiers tourné en ridicule par l’auteur, Keiji demeure certes le héros de Rooster Fighter mais il ne manque jamais de créer les situations prêtant à rire de lui. A ses côtés, Piyoko fera office de faire-valoir humoristique tandis qu’Elizabeth sera en quelque sorte la voix de la raison, celle qui saura remettre tout le monde sur des rails sensés quand Keiji manque de recul, sinon de pertinence.
Sur ces bases-là, il est aisé de voir en quoi Rooster Fighter a tout du shonen, tout du moins au sens dans lequel ce terme a été popularisé par un abus de langage auquel je me suis moi-même laissé aller depuis le début de cet article. En effet, shonen ne désigne pas à l’origine un genre ou un style mais bien un type de manga défini en fonction de son public-cible, en l’occurrence principalement des jeunes garçons/adolescents (en opposition au shojo donc qui vise les mêmes catégories d’âge mais sur un public féminin, et au seinen, pour un public plus adulte). S’il ne fait aucun doute que Rooster Fighter est effectivement un shonen, le terme que nous devrions employer ici pour désigner son style est plutôt nekketsu. Il s’agit là du processus narratif le plus connu dans les shonen, popularisé par Dragon Ball essentiellement mais également par d’autres grandes sagas telles que One Piece, Naruto, Saint Seiya ou encore Bleach.
Evidemment, le nekketsu n’est pas quelque chose de figé et chacune des œuvres que je viens de citer en reprendra certains codes forts et en laissera d’autres de côté. C’est le cas également de ce que propose Shu Sakuratani ici, lui qui va dans une plus ou moins grande mesure se réapproprier ces codes. Ainsi nous retrouvons-nous effectivement avec un personnage principal aux capacités hors-normes, porté par un objectif dont il ne peut se détourner. Globalement honnête en dépit de certains de ses traits les plus controversés (son rapport aux personnages féminins notamment), il peut également se révéler tout à fait naïf (en particulier en ce qui concerne l’image qu’il a de lui-même ou des autres). L’abnégation de Kieji, capable de se relever plus fort alors que la situation semble désespérée, entre également en ligne de compte, de la même manière que le fait qu’il s’entoure progressivement d’alliés/amis.

Cependant, ce qui va classer Rooster Fighter dans une case encore à part parmi tous ces mangas, c’est la conscience dont il fait preuve d’être ce qu’il est. Pour le dire plus clairement, Shu Sakuratani n’a pas composé son manga que comme un shonen/nekketsu « classique » : il en a fait une parodie. Sans aller jusqu’au bout du processus toutefois, l’auteur a en effet composé son récit et son dessin – qui me rappelle aussi Gon de Masashi Tanaka pour la qualité de certains détails – de manière à non seulement reprendre les codes du genre mais aussi à en rire, à les tourner en ridicule parfois.
Dans un joli travail de réappropriation, il offre à sa série un équilibre inattendu entre toute une dimension assez premier degré et une autre beaucoup plus légère, teintée d’un humour très efficace. Ces codes que j’évoquais plus haut, les voilà tordus, exagérés pour créer le rire. Rooster Fighter développe alors un humour qui lui est propre et qui fonctionne non seulement parce que les gags sont souvent très drôles mais aussi et peut-être surtout par la mise en écho qu’ils proposent avec les clichés du genre.
Si premier degré puisse-t-il être en tant que personnage, Keiji met ainsi souvent à mal la figure du héros typique qu’il véhicule, bien malgré lui. Que ce soit dans les postures fortes désamorcées par un autre personnage, par les punchlines aussi empreintes de fierté que drôles parce que finalement assez désuètes ou par le vocable employé et auquel la traduction française d’Alexandre Fournier rend d’ailleurs tout à fait honneur (« Cocori-K.O. » quand même, quelle merveille de jeu de mots), tout est fait pour dédramatiser les aspects les plus sérieux du genre.
On pense ici à la mise en scène volontairement exagérée au détour de certaines cases, comme pour souligner le côté un peu ridicule de l’aspect ultra-solaire donné parfois à certains héros, tout comme on pensera à cette répétition à outrance de certains gimmicks de Keiji, lui qui répète inlassablement « Vous…me débectez ! » ou « Je n’ai qu’un seul objectif… ». Shu Sakuratani semble s’être profondément inspiré des grands maîtres du manga, d’Akira Toriyama à Leiji Matsumoto par exemple, pour développer son propre univers mais aussi pour toujours mieux en détourner l’influence.
La recherche d’une différence

Mais derrière cette façade humoristique à peine voilée, Shu Sakuratani ne cherche jamais ni à renier ses influences, ni à les tourner en ridicule. Bien au contraire, je pense qu’il faut plutôt y voir un hommage amusé, dans lequel on trouvera un recul pertinent de l’auteur sur le genre auquel il s’adonne ici. Désacralisant la formule, le mangaka n’en oublie cependant pas de livrer un récit efficace. Sans jamais négliger son intrigue, il tache de livrer à chaque chapitre un scénario qui appelle le lectorat à revenir. L’on n’ira certes pas défendre Rooster Fighter sur l’autel de l’originalité (le héros solitaire qui combat des monstres a priori plus fort que lui, on connaît bien) mais le fait est que ce récit prend assez bien. S’il ne sort pas toujours des sentiers battus, il évolue tout de même selon moi en appliquant une rythmique narrative très agréable à suivre, équilibrant avec justesse temps morts, séquences d’action et flashbacks tout en émaillant l’ensemble de rebondissements bien sentis, sinon inattendus.
Surtout, Shu Sakuratani ne se contente pas du statu quo qu’il impose d’entrée de jeu et son manga évolue avec le temps. Au terme des 5 tomes disponibles en France jusqu’à présent, Rooster Fighter a en effet su conserver son style et son identité mais a néanmoins su se renouveler. A mesure que l’on avance dans le récit, impossible de ne pas constater la façon dont il gagne en noirceur. Evidemment, les fondements de la série ne sont jamais abandonnés et l’auteur continue de multiplier les traits d’humour bien sentis, mais le fait est que l’ambiance générale du manga se veut finalement plus pesante.
Une évolution qui se fait pour beaucoup dans les deux derniers tomes publiés pour être exact et dans lesquels Keiji et ses comparses se retrouvent dans des situations plus dures qu’à l’accoutumée, sinon véritablement plus dramatiques (cf. la toute fin du tome 5). Dès lors, le manga s’inscrit dans une nouvelle dynamique, mêlant ce gain en sérieux et cette envie de conserver la patte humoristique. Le ton est rééquilibré et amène progressivement la série vers autre chose et, au point où nous en sommes des parutions françaises, il sera intéressant de voir comment cette nouvelle énergie va prendre dans les prochains tomes et si Rooster Fighter va chercher à réduire la part d’humour au profit d’un texte voulu plus mature. Au fond, cette dureté qui gagne le récit semble vouloir rapprocher le manga du seinen car s’il a par exemple toujours été relativement violent, le manga a gagné en brutalité ces derniers temps.

Ces changements, Shu Sakuratani les fait intervenir jusque dans la place qu’occupent les kijû, fameux antagonistes de son manga. Progressivement, et même s’ils demeurent la menace majeure de la série et que le kijû blanc conserve son statut d’objectif final pour Keiji, la place de ces monstres trouve elle aussi une nouvelle place. Mis en retrait à la faveur de certains tomes, ils glissent doucement du statut de principale menace à celui d’élément perturbateur initial, d’arbre qui cache la forêt si l’on veut.
Cela n’enlève cependant rien à la symbolique qui entoure les kijû, lesquels sont non seulement les « grands méchants » de l’histoire mais aussi une façon de véhiculer un propos sur les travers des humains. Shu Sakuratani, par ces monstres, matérialise diverses émotions ou actions négatives (la solitude, le besoin de reconnaissance, l’avarice et l’appât du gain, entre autres) afin de leur donner une matérialité propre. En érigeant ces vilains aspects en créatures hideuses, le mangaka s’amuse à souligner le caractère non seulement néfaste de ces derniers mais également funeste, étant donné que l’affrontement entre un kijû et Keiji se solde en règle générale par la mort du monstre.
En cela, Rooster Fighter rappelle par ailleurs qu’il n’est pas qu’un shonen ou nekketsu de plus, sans autre ambition que celle de rebondir sur les ressorts habituels du genre. Il prend le temps, au détour de ses scènes d’action réjouissantes, de développer une thématique et de s’y tenir. Ce faisant, Rooster Fighter se paie le luxe de ne pas seulement compter sur sa force de shonen un peu classique. Si son propos demeure toutefois assez convenu (« être vilain, c’est mal »), on lui reconnaîtra l’envie d’en faire quelque chose, de le concrétiser sous une forme qui arrive à faire partie intégrante de l’esprit nekketsu.
Du reste, tout ceci opère un glissement comme je le disais plus haut. A mesure que l’on progresse dans la lecture, le traitement de cette part du récit change et se contorsionne, lui ôtant de fait le risque de tourner en rond. Le personnage de Moro, un kijû atypique, sera une des premières pierres à cet édifice. Par le truchement de ce protagoniste, Sakuratani opère une première mue dans son univers en en déboulonnant certains fondements. La chose semble bien entendu assez classique dite comme ça mais j’y trouve dans Rooster Fighter une pertinence à laquelle je ne me serais pas forcément attendu de prime abord.
Ce que ce détail (qui n’en est pas un) me révèle en définitive, c’est qu’en dépit de ses allures de divertissement pur et dur, parfois irrévérencieux, le manga de Sakuratani n’en oublie pas de se montrer un tant soit peu réfléchi sur la façon dont il se construit. Il n’est pas question ici, comme dans certains shonen, de seulement juxtaposer les situations pour ainsi virevolter d’arc scénaristique en arc scénaristique. Au lieu de cela, ce mangaka préfère diluer les changements qui s’opèrent dans son intrigue.
Il ne va pas se contenter de mettre Keiji face à une menace donnée pour ensuite passer à la suivante, mais va plutôt lui apporter des retournements de situation bienvenus qui vont permettre d’éviter à Rooster Fighter de sombrer dans une évidence triste et des ça-va-de-soi trop attendus. Cette formule, l’auteur la répète en plusieurs occasions, avec une force plus ou moins grande et les récents événements de l’aventure confirment sa nécessité, mise au service d’une intention plus que louable : éviter de sombrer dans les écueils de la redondance et du classicisme. Rooster Fighter réussit ce paradoxe en définitive, celui où il arrive à être une œuvre profondément ancrée dans le genre qui est le sien tout en en ayant conscience avec une lucidité qui l’empêche de se contenter de ça. Et rien que cela, c’est un bel argument.
Sur le papier, Rooster Fighter a donc tout du shonen classique. Pétrie des codes qui régissent ce pan de la culture manga, la série de Shu Sakuratani aurait très bien pu passer inaperçue. Mais à l’instar de ce coq qui lui sert de héros, elle cache bien son jeu. Divertissant au possible, finement exécuté et bien moins bas du front qu’il pourrait prêter à le croire, Rooster Fighter est surtout une excellente surprise. Derrière les aventures de Keiji se cache selon moi un petit air frais d’originalité dont la discrétion ne l’empêche pas de faire mouche. Nous en sommes à 5 tomes à l’heure actuelle en France et j’ai véritablement hâte que la suite arrive, surtout après le cliffhanger final du dernier volume !


Laisser un commentaire