Il était plus que temps de revenir au cinéma. Une affirmation valable tant pour ce blog, qui n’a pas eu de chronique ciné depuis un sacré bout de temps, que pour moi-même, qui n’avais plus remis les yeux devant un grand écran depuis tout aussi longtemps. Petit à petit, armé d’une nouvelle carte UGC, me voilà donc à reprendre mes bonnes habitudes. Si divers films tels que Emilia Pérez, Le Comte de Monte-Cristo ou encore Alien Romulus ont ainsi pu occuper quelques unes de mes dernières séances, c’est finalement Nosferatu qui m’a donné envie d’écrire quelque chose. Parce que la dernière réalisation de Robert Eggers m’interroge autant sur ce qu’on peut encore attendre d’une nouvelle version de cette histoire que sur la façon dont le cinéaste s’est peut-être un peu oublié en chemin.

Robert Eggers ou la résurgence du cinéma gothique
Robert Eggers fait partie de cette frange de cinéastes qui arrivent tout d’un coup et semblent mettre à peu près tout le monde d’accord assez rapidement. En l’espace de trois films seulement, le réalisateur américain a réussi à s’imposer comme un des créateurs incontournables de la deuxième moitié des années 2010 et de ce début des années 2020. Incontournable mais pas d’unanimité. Et si l’on serait bien soupçonneux si tel avait été le cas (on s’imagine mal un monde où un artiste réussit à mettre littéralement tout le monde dans sa poche), il va de soi que le style d’Eggers n’a de toute façon rien pour permettre d’être apprécié par le public le plus large.
The Witch en 2015 divisait déjà la critique et le public mais c’est sans doute The Lighthouse, quatre ans plus tard, qui aura été le premier grand marqueur dans la carrière du réalisateur. Les choix s’accumulent en effet dans ce film pour en faire un brûlant sujet de discussion : huis clos en noir et blanc dans un phare avec deux personnages dont la folie ne va aller qu’en s’amplifiant à mesure que le film avance, le tout à grand renfort d’une mise en scène soulignant chaque aspérité de ces deux personnalités, il y a de quoi faire parler.

Reste qu’avec ces films, puis The Northman en 2022, Robert Eggers n’a sans doute pas gagné une unanimité franche – qu’il n’a de toute façon très certainement jamais recherchée étant donné son style (on laissera cette inutile quête à Disney et Marvel) – mais il a su imposer une patte franche, renouvelant notamment la manière de penser et dépeindre l’horrifique à l’écran. Il serait sans doute aisé de le cantonner à une étiquette gothique mais je crois que la façon de filmer d’Eggers va un peu plus loin que cela. Convoquant dans ses œuvres un certain nombre d’influences et d’intentions, il prolonge à mon sens le cinéma gothique tel qu’il a pu se cristalliser autour des propositions de la Hammer par exemple, entre les années 1950 et 1970 notamment, puis avec des cinéastes plus contemporains tels que Guillermo Del Toro, Francis Ford Coppola (avec son Dracula) ou surtout Tim Burton (lequel avait déjà bien imprégné le gothique de sa propre personnalité). Je ne saurais vous dire avec certitude que l’on peut parler de néo-gothique en ce qui concerne Robert Eggers mais je crois que ce n’est pas totalement faux de le dire.
En effet, il semble pousser un peu plus loin les critères esthétique du gothique, dont le Nosferatu original de Murnau fait par ailleurs figure de précurseur. Il en partage pourtant un certain nombre : romantisme noir, mélancolie, inspirations prises dans des univers médiévaux, fantastiques ou de l’ère victorienne… Néanmoins, si prégnante que puisse être cette influence dans le travail de Robert Eggers, se dernier tisse petit à petit un univers qui l’amène à s’en écarter progressivement et ponctuellement, voire à en prendre le contrepied. Je pense notamment à la question du corps.

Central dans la plupart des œuvres gothiques, le corps est le plus souvent représenté sous un jour nouveau, certains diront transfiguré.
Un changement de paradigme vis-à-vis des représentations précédentes (et notamment romantiques) où la question du corps demeure mais soit en s’inscrivant en opposition avec les canons de beauté véhiculés par la société, soit en mettant en scène des corps difformes, des monstres. Objet d’un travail précis et minutieux, la représentation du corps dans le cinéma gothique fait l’objet d’une attention au moindre détail, qu’il s’agisse de la physionomie, la coiffure, les atours divers, etc. Il s’agit presque en quelque sorte, si l’on voulait résumer, de chercher le beau dans autre chose que ce à quoi nous avons été habitués, de chercher une autre forme de beauté. Un aspect qui transpire énormément dans le travail de Tim Burton évidemment et qui trouve à mon sens son pinacle dans Edward aux Mains d’Argent, où Burton oppose sans cesse la beauté atypique et noire d’Edward à celle, conventionnelle et en fin de compte ridicule, de la société colorée à l’outrance dans laquelle il se retrouve projeté.
Dans ses propres films, Eggers conserve une attention particulière aux corps mais en envisageant la chose différemment. Il ne s’agit plus de faire ressortir la beauté d’un individu en opposition avec les canons admis. Au contraire, Eggers s’emploie plutôt à mettre en scène le corps comme une extension du propos sombre et horrifique qu’il développe dans les récits qu’il met en scène. On pense par exemple aux allures torturées données à Robert Pattinson et Willem Dafoe dans The Lighthouse ou bien, en ce qui concerne notre sujet, au comte Orlok dans ce récent Nosferatu. En définitive, on pourrait presque se dire que The Northman fait figure d’exception en la matière, l’imposante musculature d’Alexander Skarsgård ne visant clairement pas les mêmes fins.

Reste qu’hormis ce cas précis, Eggers s’amuse à détourner et déformer les corps, les installant comme des extensions du récit et des thèmes abordés, ainsi que comme une expression de ce qui trame au plus profond de ses personnages.
En cela, le réalisateur s’inspire surtout du cinéma expressionniste allemand, courant qui infuse dans chacune de ses œuvres par divers aspects et qui s’observe très logiquement beaucoup dans Nosferatu (la version de F. W. Murnau fait partie de ce courant). En effet, comme nous le rappelle Marie-Bénédicte Vincent, ce mouvement cinématographique repose pour beaucoup sur « la distorsion des objets et des corps, l’expression du visage comme un dérangement, un désordre ». Une affirmation que l’historienne présente dans son article « L’univers du cinéma expressionniste allemand », qu’elle publie dans le n°94 de la revue d’histoire Vingtième Siècle en 2007. Un article où elle cite notamment Herwarth Walden, directeur de la revue Der Strum et qui présentait en 1910 l’expressionnisme allemand (jusqu’alors surtout consacré dans la peinture) comme « un art qui donne une forme à une expérience vécue au plus profond de soi-même ».
En l’espace de 10 ans, Robert Eggers n’aura donc sorti « que » quatre films mais tous contribuent à établir le style du réalisateur. Empreint d’influences marquées, son cinéma réussit selon moi à imposer une vision quelque peu renouvelée de l’horreur, de l’angoisse et de la façon de mettre en scène ces atmosphères. Avec Nosferatu, on s’attend à deux choses finalement : voir la façon dont Eggers parviendra ou non à marquer cette nouvelle adaptation de son sceau, à en faire une œuvre personnelle qui tranchera par rapport aux précédentes itérations ; puis voir s’il arrivera à éviter l’écueil que représente le fait de s’attaquer à l’un des films les plus importants du courant expressionniste qui l’inspire tant.
Sous influence
Arriver devant Nosferatu en 2025, c’est finalement s’installer dans son siège en s’attendant à plusieurs choses. Ce que l’on espère déjà, c’est retrouver l’esthétique léchée et sombre de Robert Eggers, d’autant plus avec un film comme celui-ci.
Ensuite, on se demande dans quelle mesure le réalisateur aura tenté une réinvention ou une réinterprétation de ce récit. Il faut bien avouer que l’histoire de Nosferatu, elle-même tirée en droite ligne de celle de Dracula, on commence à la connaître par cœur tant le sujet a été adapté. Aussi on s’attend à ce qu’une nouvelle version, à une heure où les vampires n’ont plus tant la cote, permettrait de dépoussiérer le récit, sinon de le moderniser en s’offrant quelques libertés.
Et enfin, à la conjonction de tout cela, on s’interroge sur la façon dont le cinéaste, pour lequel le cinéma expressionniste allemand constitue une influence majeure donc, arrivera à dépasser cette influence dans son adaptation d’un des films phares de ce mouvement. Mais avant toute chose, prenons le film pour ce qu’il est, sans trop nous poser de questions sur les influences d’Eggers ou le fait que ce soit un remake.

Compte tenu de la carrière du réalisateur jusqu’à présent, quiconque arrive devant son dernier film en date s’attend à la projection d’une œuvre visuellement très travaillée. Avec chacun de ses précédents films, et ce dans des propositions qui se croisent mais ne se ressemblent jamais tout à fait, Eggers a effectivement su faire preuve d’un talent indéniable quant à sa capacité à créer des images fortes dans des tableaux imposants mais également à faire de l’image une extension directe du récit, hors-texte, soulignant le plus souvent le propos, le ton ou les thématiques. Appliquant en cela une mécanique habituelle du cinéma, le réalisateur tâche tout de même d’y porter un soin particulier.
Le mérite en revient d’ailleurs également à Jarin Blaschke, directeur photo attitré d’Eggers avec lequel ce dernier a composé l’imagerie de chacun de ses films. Ensemble, les deux artistes ont développé et peaufiné ce qu’il conviendrait finalement d’appeler « le style Eggers », fait de grands tableaux qui vous éclatent au visage par leur noirceur au service de laquelle un jeu d’ombres et de lumières et constamment mis en œuvre.

Comme attendu, ce travail se retrouve dans Nosferatu. Une évidence en soi, ne serait-ce qu’en raison de la nature originelle de ce projet : un film de vampire venu tout droit de l’expressionnisme allemand et réadapté d’un récit emblématique de la littérature dite néo-gothique britannique (le Dracula de Bram Stoker donc, en 1897). Ce remake qu’en fait Robert Eggers se veut alors être le terrain idéal pour appliquer sa patte, voire même la porter plus en-avant. Et le fait est que l’affaire prend des atours très intéressants dans l’ensemble. Epousant le lugubre inhérent au récit, la mise en scène de Nosferatu ne manque pas de qualités.
En effet, Eggers et Blaschke nourrissent le film de cette noirceur à laquelle ils nous ont habitués, dans un mouvement logique et efficace qui amplifie encore l’impact de ce récit. On pense ainsi à ces grands tableaux que ce Nosferatu nous donne à voir, comme lors de cette séquence où Hutter est en route pour le château à bord de cette inquiétante calèche. Une séquence où la bâtisse d’Orlok se dessine au loin, dans la nuit, sans rien d’autre à observer que ce véhicule qui serpente sur le sentier. Par ce seul plan, Eggers souligne à la fois la solitude d’Hutter face au sort qui l’attend ainsi que l’inéluctabilité de ce dernier. Un sort qui se profile au bout d’un cheminement tortueux où les méandres de la route évoquent déjà ceux de la terreur qui va bientôt s’abattre. D’autres plans évidemment s’ajoutent à cela (celui où Hutter est seul dans la forêt, dans l’attente de la fameuse calèche) mais tâchons d’éviter une énumération trop longue.

Au lieu de cela, évoquons plutôt l’autre effet recherché dans Nosferatu, à savoir la mise en scène d’une menace qui grandit et se rapproche sans cesse. La chose se fait de deux manières. La première d’entre elle consiste à mettre progressivement les personnages en scène dans des milieux plus étroits, à mesure que Nosferatu approche. Ainsi est-ce le cas lors de la rencontre entre ce dernier et Hutter au château. La scène entière du dîner joue non seulement sur le mystère autour de l’apparence du vampire mais également sur un jeu de rapprochement progressif, cumulant les gros plans et les zooms sur Hutter de manière de plus en plus prononcée, comme pour appuyer la façon dont la créature installe son emprise et sa menace sur le jeune homme mais sans jamais le montrer véritablement (ce que le film fera toutefois ultérieurement). D’autres séquences, notamment dans la ville de Wisborg, joueront le même jeu en s’employant à tirer avantage de ses rues étroites, où la menace du vampire et de la peste ne font que contribuer à les rendre toujours plus étouffantes.

L’autre manière d’accentuer la façon dont la menace pèse de plus en plus consiste pour Eggers à reprendre à son compte le jeu d’ombres que Murnau avait en son temps mis en place dans son propre film.
Souvenez-vous notamment de la séquence où le réalisateur allemand ne nous montrait que l’ombre de Nosferatu, montant un escalier, ou de celle de sa main qui grimpe sur le corps d’Ellen. De nouveau, l’effet de style sera employé ici et ce de manière plus prononcée qu’en 1922. Dès la scène d’ouverture, Eggers joue de cet effet en mettant en scène le vampire de manière immatérielle, n’en faisant qu’une ombre dans les rideaux de la chambre d’Ellen. On retrouvera un effet similaire avec ce plan d’une ombre qui s’étend sur la ville, en vue aérienne, ombre qui prend la forme de la main de Nosferatu. Un plan intelligent qui symbolise à la fois l’arrivée du vampire, l’épidémie de peste qui ravage peu à peu Wisborg et l’emprise que Nosferatu réussit à imposer sur les personnages, qu’il s’agisse de son serviteur Knock ou d’Hutter, sa femme et leurs amis, le tout en cristallisant le caractère supérieur du monstre par rapport au commun des mortels.
Sur le papier et au premier coup d’œil, l’ensemble du travail esthétique réalisé sur cette nouvelle itération de Nosferatu peut se montrer séduisante. Eggers et son directeur photo semblent avoir voulu offrir un bel écrin à leur version du mythe, dont on se doute qu’il est un pilier fondamental de leur culture et de leur cinéphilie communes. Du reste, j’y trouve à titre personnel plusieurs choses à redire.
Mon premier souci, c’est qu’à force de vouloir faire toujours plus sombre, sinon plus sombre que sombre, ce Nosferatu le devient trop et se perd un peu dans une intention qui manque peut-être de limites. Si je reprends l’exemple que je citais plus haut (celui de la calèche sur la route vers le château), les détails de la composition sont certes plaisants, mais le fait est qu’on n’y voit pas grand-chose sur le coup. Noire pour être noire, plongée dans une nuit dont la colorimétrie rappelle le bleu des séquences nocturnes de la version teintée (que je recommande chaudement) du film de Murnau, la scène manque à mon sens de finesse dans les contrastes. Une délicatesse qui aurait pourtant été bienvenue et aurait sans doute embelli encore l’image ainsi proposée à notre regard. Cette remarque, je me la suis faite à plusieurs reprises pendant mon visionnage. Je me dis qu’Eggers a certainement voulu se réapproprier les tons du film original en y apposant sa patte mais peut-être y est-il allé trop franchement. J’y vois le résultat d’une tentative du réalisateur, celle de reprendre à son compte l’essence du cinéma expressionniste allemand et d’en faire quelque chose de personnel, comme s’il avait voulu lui rendre hommage. Mais l’homme semble avoir glissé vers l’exercice de style un peu scolaire.

Et c’est sans doute cela qui me pose le plus problème avec ce Nosferatu. Sans être dénué de qualités, le remake se veut bien timide par rapport à ce que Robert Eggers aurait pu lui apporter sur le papier.

J’ai le sentiment en fin de compte que l’influence du cinéma expressionniste a été mal apprivoisée par le réalisateur américain.
L’occasion était belle pour lui de faire valoir cette influence dans un film qui s’y prêtait par nature mais je garde l’impression qu’il s’est laissé enfermer dans ce choix. C’est d’autant plus étonnant finalement que je trouve que l’influence de ce mouvement du début du XXème siècle se ressent en fait beaucoup plus dans ses deux films précédents. Par son imagerie et les grands tableaux composés avec minutie, The Northman réussissait à mon sens bien plus cet exercice de réappropriation et de modernisation (je pense ici à la mise en scène de la valkyrie). Quant à The Lighthouse, son travail sur la déformation des expressions et des corps des personnages est à mon sens bien plus en phase avec l’expressionnisme allemand que ne l’est le même exercice dans Nosferatu.
Car il y a bien de cela dans le dernier-né d’Eggers mais là encore, le réalisateur m’a donné le sentiment d’en faire trop, à trop vouloir bien faire. Malgré lui, il s’est placé dans l’ombre de cette influence et a manqué d’originalité dans sa proposition, conduisant – sur cette question-là – à une surenchère un peu hors de propos. Car si l’exagération du jeu peut être vue comme une note fondamentale des œuvres telles que le Nosferatu de Murnau, il ne faudrait pas la confondre avec un surjeu qui prédomine malheureusement chez Eggers. Et pourtant, j’aime beaucoup Nicholas Hoult et Aaron Taylor-Johnson, tout comme je dois convenir que cette découverte de Lily-Rose Depp fut une bonne surprise. Mais la surenchère constante m’a fait tiquer en une multitude d’instants. Au final, il n’y a guère qu’avec Willem Dafoe que ça ne m’a pas trop dérangé mais parce que l’acteur est coutumier de cette façon de jouer, qu’il maîtrise avec talent.


En définitive, si Robert Eggers semble s’être pris les pieds dans l’hommage qu’il voulait sans doute rendre au cinéma allemand d’antan, je crois que ce n’est qu’une partie du problème. Etant sans certitude quant à ce qui me questionnait, j’ai regardé le Nosferatu de Murnau quelques jours après avoir vu cette version moderne et c’est là que j’ai été convaincu : Eggers n’a en réalité pris que très peu de libertés par rapport au matériau de base. Dès le début du film de Murnau, on voit en quoi le résultat moderne manque d’originalité et d’audace. Non pas qu’il en soit dépourvu mais il aurait pu, et sans doute même dû, aller beaucoup plus loin. Les deux films frais dans ma mémoire, il me reste l’impression que Robert Eggers s’est « contenté » d’extrapoler, tout en ajoutant à ce dernier une surcouche d’onirisme cauchemardesque. La scène du rituel des Tziganes en Transylvanie sera par exemple un des ajouts répondant de cette démarche. Mais au final, ces suppléments qu’Eggers égraine dans son film manquent peut-être de pertinence, en dépit de leurs qualités artistiques et de la manière dont il sous-tendent les thèmes de l’histoire.

Ce que je veux dire par là, c’est que ces efforts, si louables soient-ils, semblent finalement un peu vain quand on prend le film dans son ensemble et qu’on se rend compte que le tout ressemble par fois quasi plan pour plan à la proposition originale de Murnau. Alors oui, Robert Eggers force le trait, accentue l’horreur, il la modernise, mais cela reste entaché par le conformisme d’un récit qui se soumet tout entier à son illustre modèle. Un modèle qui, par ailleurs et malgré tout le respect qui lui est dû, n’inventait déjà pas grand-chose puisque le scénario du Nosferatu de 1922 est une copie de l’histoire narrée dans le Dracula de Bram Stoker. Afin de ne pas payer les droits d’adaptation, le scénariste Henrik Galeen avait à l’époque repris l’histoire en en modifiant les noms et quelques détails (transposant notamment l’action d’Angleterre en Allemagne), mais la trame restait extrêmement proche (ce qui aura valu un procès pour plagiat intenté par Florence Stoker, veuve de l’auteur de Dracula).

Et voilà donc Robert Eggers qui arrive plus de 100 ans plus tard avec une nouvelle version qui va pousser la référence jusque dans le texte (Ellen qui demande à Hutter « Pourquoi les as-tu tuées, ces belles fleurs ? » ou bien Orlok qui accueille ce même personnage en lui reprochant « Vous m’avez fait attendre »…) et sans déroger d’un iota à la trame que le récit de Galeen avait tracée à l’époque. Eggers pousse le vice jusqu’à emprunter également à Werner Herzog, à qui l’on doit une autre célèbre version. En effet, si la séquence où Ellen se rend au cimetière près de la plage figure déjà chez F. W. Murnau, c’est esthétiquement parlant bien plus à la version qu’en livre Herzog qu’elle renvoie.
Nosferatu à la mode de 2024 n’est donc pas un mauvais film en soi. Pétrie de qualités évidentes dans la mise en scène comme dans la musique de Robin Carolan que j’ai totalement oublié d’évoquer, l’œuvre souffre surtout de son incapacité à véritablement se détacher son modèle, lequel vampirise chaque goûte de la créativité pourtant salvatrice dont Robert Eggers aurait pu faire preuve. Reste cependant un bastion dans lequel le réalisateur semble avoir mis plus de billes : le vampire lui-même.
La figure du vampire chez Eggers
Sans tourner autour du pot, c’est à tous points de vue dans la façon dont il a réinterprété le personnage d’Orlok/Nosferatu que Robert Eggers s’est le plus illustré à mon sens. Un travail de fond comme de forme autour du personnage, lequel apparaît assez transfiguré si on le compare avec les incarnations que Max Schreck puis Klaus Kinski nous ont léguées.

Dès lors, le traitement de la figure du vampire chez Eggers passe par plusieurs choses, dont la première est une recomposition visuelle du personnage de Nosferatu. En effet, si l’on retrouve quelques traits de la créature telle qu’elle a été caractérisée par Schreck en 1922 puis Kinski en 1979, l’apparence établie chez Eggers dénote nettement. Parmi les points communs, on pensera notamment au dos vouté du vampire, qui se tient le plus souvent avec la tête rentrée dans les épaules, mais également aux oreilles. Sans être véritablement pointues, comme elles pouvaient l’être chez Murnau et Herzog, elles s’en approchent cependant par une apparence abimée, décharnée, dont les dégradations évoquent une forme pointue.
Reste que malgré ces traits similaires, finalement peu nombreux, le vampire ici incarné par Bill Skarsgård a une allure qui lui est propre, moins stéréotypée que les précédentes incarnations, lesquelles dressaient un strict parallèle entre Nosferatu et la chauve-souris. Que ce soit par ces fameuses oreilles, par le regard ou par les deux dents saillantes qui caractérisent le Nosferatu « classique », bien des détails contribuent à cette filiation entre la créature et l’animal. Ces éléments disparaissent presque totalement chez Eggers, qui mise plutôt en ce qui le concerne sur un personnage qui porte dans son apparence la malédiction qui le frappe et qu’il déploie sur les autres. Point ici d’allure cadavérique ou de peau lisse telles que vues dans les précédentes versions, Orlok est marqué dans la chair par sa condition. La peau du vampire est abimée en de nombreux points de son corps qu’Eggers nous dévoilera d’ailleurs sans frilosité.

Un corps par ailleurs grand, massif, charpenté. Une allure qui ajoute en définitive un caractère presque titanesque au personnage, lequel fait montre d’une force physique certaine en de multiples occasions (notamment lors de la séquence au château, lorsqu’Hutter découvre la nature de son hôte). Je sais que tout le monde n’a pas été client de cette transfiguration du personnage mais, à titre personnel, je trouve cela intéressant. L’idée d’en faire presque un colosse permet à Eggers de sortir le personnage de son carcan habituel et de lui faire véhiculer autre chose. Par cet aspect, Nosferatu voit du poids ajouté au danger qu’il représente.
En fin de compte je le trouve bien plus menaçant qu’il ne l’était chez Murnau à l’époque ou chez Herzog ensuite, délaissant l’approche digne du romantisme noir pour une vision plus moderne du personnage. Le caractère inquiétant de Nosferatu est déplacé. D’une menace insidieuse cachée derrière les allures de notable/dandy perverti qu’on notait chez Murnau et Herzog (et qui découle, je pense, de l’allure d’aristocrate dandy de Dracula lorsqu’il charme Mina à Londres dans le roman de Stoker), la chose devient ici brutale et violente, jusque dans l’apparence et la stature donc.
L’autre aspect qui viendra nourrir la figure du vampire dans ce film, c’est très nettement la remise au centre du parallèle entre la créature et les thèmes de la sensualité et de la sexualité. Le vampire a, depuis bien longtemps, souvent été associé une figure éminemment charnelle. Une vision qui prône régulièrement une liberté sexuelle sans ambages, la transgression également et, par extension, une opposition aux restrictions sociales en la matière. On ne compte plus aujourd’hui le nombre d’œuvres mettant en scène des vampires et qui vont toucher de près ou de loin avec la romance, la sensualité et la sexualité. Dracula en est évidemment un exemple des plus célèbres, tant pour la scène où Jonathan Harker reçoit la visite de trois séduisantes femmes dans le château du comte que pour la quête charnelle de Dracula vis-à-vis de Mina.
Mais à côté de cet emblématique exemple, comment ne pas penser à Carmilla, roman de Joseph Sheridan Le Fanu paru en 1872 (soit 25 ans avant Dracula) et qui met en scène Carmilla, une vampire lesbienne. On pourra enfin aussi citer Entretien avec un Vampire, Génération Perdue, Buffy contre les Vampires, Twilight ou même Vampire Diaries. A différents degrés ou sous différents angles (Twilight va par exemple inverser le propos en prônant une forme de chasteté puritaine), toutes ces œuvres se relient à un moment ou un autre à ces questionnements, qu’il s’agisse de parler de libertinage, d’éveil à la sexualité ou d’homosexualité plus spécifiquement.

Cette vision du vampire transparaissait déjà chez Murnau et sans doute plus encore chez Herzog, tout comme Coppola avait su la mettre en scène dans son adaptation de Dracula en 1992. Nulle surprise donc à voir Eggers s’intéresser à cette thématique, tout comme il n’y a aucune surprise à le voir plonger dedans plus en-avant encore que ses prédécesseurs. Forçant le trait, insistant, le réalisateur installe cette dimension dès la scène d’ouverture de son film. Une introduction où le lien charnel et sensuel entre Orlok et Ellen est directement établi pour ensuite servir de fil conducteur à l’ensemble de l’intrigue. En serpent de mer, ce lien ressurgit régulièrement afin de donner à ce nouveau Nosferatu l’occasion de pleinement se démarquer des précédents grâce à cet aspect. Eggers dénature la quête de Nosferatu vis-à-vis d’Ellen (chez Murnau, cela s’apparentait presque à un « banal » coup de foudre) pour y installer autre chose. Le vampire dépasse alors son seul statut de créature de la nuit.

Plus que de vouloir sucer le sang de la jeune femme, c’est elle toute entière qu’il désire plus que tout et, conjointement à cette apparence et cette stature que j’évoquais plus haut, Orlok s’impose en mâle terrifiant, prêt à tout pour obtenir la femme qu’il désire, même si cela implique de la perdre ensuite. Seule compte son attirance pour elle. Une attirance psychique, régulièrement mise en avant dans le film par le lien télépathique qui unit les deux personnages et par les séquences de transe d’Ellen, mais aussi et surtout physique, laquelle trouvera sa concrétisation ultime dans la scène finale du film, en une métaphore brutale et à peine voilée du viol. La façon dont Eggers a su employer le personnage de Nosferatu pour en revoir le propos, ou plutôt pour l’exprimer d’une manière plus franche, est donc un beau travail en soi. Mon regret sera que le cinéaste, jamais frileux à l’idée d’en rajouter un peu, se soit senti obligé de porter la thématique sexuelle plus loin, notamment lors de deux scènes qui, en plus d’être assez mal amenées, font plus montre de vulgarité qu’autre chose (ajoutant notamment au récit un acte nécrophile implicite totalement hors de propos).
Robert Eggers me donne donc le sentiment d’avoir porté le plus gros de son effort sur le personnage de Nosferatu avant toute chose. Un choix qui porte en lui un certain nombre d’idées intéressantes mais qui m’interroge. Cela me questionne d’une part car je me demande si cette attention pleine et entière portée sur cela n’a pas empêché de mieux préparer la reconfiguration du récit tout entier. On l’a déjà un peu évoqué mais quand on prend ce Nosferatu dans son ensemble, on voit bien à quel point il colle en de très nombreux points à ce qui a déjà été fait avant. Scénaristiquement, il n’invente rien et raconte une histoire qu’on a déjà lue et vue tant de fois auparavant… Alors oui, l’effort artistique est bien présent (quoique bancal à mon sens) mais est-ce suffisant pour faire oublier qu’on suit finalement la même histoire qu’il y a un peu plus de 100 ans ?

Je pense en fait, et l’on va tacher de conclure là-dessus, que ce Nosferatu manque de radicalité. Un manque qui se ressent donc d’un point de vue scénaristique mais qui concerne aussi à mon sens le traitement du vampire. En dépit de l’intérêt que peut représenter le travail abattu par Robert Eggers sur la créature ici, lequel associe fermement le vampire à la figure du violeur, je pense qu’il aurait peut-être dû creuser dans une autre direction sur le strict plan de la mise en scène du personnage et développer plus en-avant ce qu’il a pourtant installé à l’écran dès le prologue. Une introduction où, rappelons-le, Nosferatu n’apparaît qu’en ombre, laquelle se dessine dans le flottement des rideaux de la chambre d’Ellen. De cette manière, Eggers installe non seulement le lien psychique qui unit les personnages donc mais il met en scène une forme de menace. A la manière dont l’ombre du vampire se dessinait sur les murs dans le film de Murnau, lequel jouait sur l’angoisse inhérente au hors-champ dans ce genre de films, Robert Eggers aurait pu continuer à développer cet aspect en ne montrant jamais frontalement le vampire.

En jouant sur des ombres, des projections, des visions, je crois qu’il aurait pu instiller une autre forme de peur que celle, un peu trop éculée aujourd’hui (et qui fait d’ailleurs redite par rapport à ce qu’il donnait à voir dans The Northman), apportée par la surdimension d’un corps et d’une force de la nature (ou contre-nature, je vous laisse le choix). Il reviendra à cette idée de ne pas montrer le vampire, par exemple avec cette séquence de l’ombre de la main qui survole la ville et que j’évoquais précédemment, mais ce n’est que trop ponctuel.
Il est bien aisé derrière mon clavier d’écrire cela, j’en conviens, mais je crois qu’il aurait été encore plus fort de ne jamais montrer le vampire, de se cantonner à ce genre d’effets, ce qui aurait par ailleurs donné l’occasion de proposer des séquences visuellement créatives, pour ne finalement le dévoiler qu’au terme du récit, lors de cette fameuse scène finale. Une conclusion qui aurait pu alors être l’apogée d’une menace qui, après avoir serpenté insidieusement tout au long du film, aurait éclaté dans un ultime déchaînement au cours duquel l’apparence renouvelée du vampire aurait sans doute gagné en effet, ajoutant donc de la force à ce climax. Il ne faut pas avoir peur de ne pas montrer le monstre et d’insister surtout sur ce qu’il arrive à provoquer sans être physiquement présent à l’écran.
Impossible de voir en Nosferatu un mauvais film, c’est indéniable. Fidèle à son style, Robert Eggers livre ici une œuvre gothique dans la lignée de ses précédentes réalisations, doublée d’un hommage à ses influences les plus chères. On regrettera toutefois que le réalisateur n’ait pas réussi à aller plus loin. Empêtré dans son hommage, coincé dans un récit qu’il n’a pas spécialement réinventé, Robert Eggers s’est égaré dans une envie, peut-être involontaire, de faire comme ses modèles. Sans pour autant seulement singer ces derniers et tout en apportant tout de même sa pierre à l’édifice qu’est le mythe de Nosferatu, il s’est un peu oublié en chemin et n’a à mon sens pas su percevoir comment véritablement réinventer tout cela. On se demande finalement si Robert Eggers ne s’est pas un peu cassé le nez sur l’exercice de la réadaptation. Et quand on voit que ses prochains projets sont un remake du Labyrinthe de Jim Henson ainsi qu’une nouvelle version du loup-garou, on s’inquiète un peu de le voir mettre le doigt dans le mauvais engrenage : celui de la machine à refaire ce qui a déjà été fait.
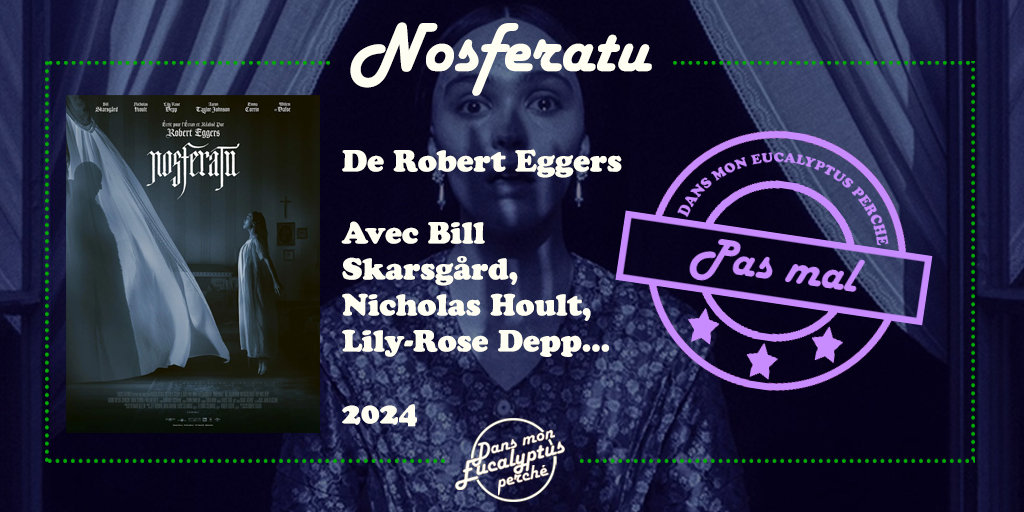

Laisser un commentaire